PREMIÈRES LIGNE #90
Bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du dimanche : premières lignes, créé par Ma Lecturothèque.
Le concept est très simple, chaque dimanche, il faut choisir un livre et en citer les premières lignes.
Je poursuis aujourd’hui avec vous ce nouveau rendez-vous hebdomadaire !
Et merci à Aurélia pour ce challenge.
Le livre en cause
Un traitre a notre goût, John Le Carré

7heures du matin sur l’île caribéenne d’Antigua, un certain Peregrine Makepiece, surnommé Perry, athlète amateur complet de haut niveau et récemment encore enseignant de littérature anglaise dans un college réputé de l’université d’Oxford, disputait un match au meilleur des trois sets contre un quinquagénaire russe musclé et chauve, aux yeux marron, au dos raide et au port altier, du nom de Dima. Les événements qui avaient abouti à ce match firent bientôt l’objet d’intenses investigations de la part d’agents britanniques que leur profession ne disposait guère à croire au hasard. Et pourtant, sur ce point, Perry n’avait rien à se reprocher.
La venue de son trentième anniversaire, trois mois plus tôt, avait précipité la crise existentielle qui couvait en lui à son insu depuis plus d’un an. Assis à 8 heures du matin dans son modeste logement à Oxford, la tête entre les mains, après un jogging de quinze kilomètres qui n’avait pas réussi à soulager son sentiment d’affliction, il avait sondé son âme pour découvrir à quoi avait servi le premier tiers de son existence, sinon à lui fournir un prétexte pour éviter de s’aventurer hors des confins de la cité aux clochers rêveurs.
Pourquoi ?
Vu de l’extérieur, le parcours de Perry était celui d’une parfaite réussite universitaire. L’élève de l’école publique, fils de professeurs du secondaire, arrive à Oxford bardé de diplômes décernés par l’université de Londres, nommé pour trois ans sur un poste offert par l’un des colleges historiques, établissement d’excellence fort bien doté. Son prénom, apanage traditionnel des couches supérieures de la société, lui vient d’Arthur Peregrine, prélat méthodiste originaire de Huddersfield qui soulevait les masses au XIXe siècle.
Pendant le trimestre, quand il n’enseigne pas, il se distingue en cross-country et autres sports, et consacre ses soirées de liberté à un club de jeunes du quartier. Pendant les vacances, il conquiert des sommets difficiles et des voies extrêmes. Mais lorsque son college lui propose un poste permanent (ou plutôt, selon la vision aigrie qu’il en a maintenant, l’emprisonnement à vie), il renâcle.
Là encore : pourquoi ?
Au trimestre précédent, il avait fait un cycle de conférences sur George Orwell intitulé « Une Grande-Bretagne asphyxiée ? » et sa propre rhétorique l’avait inquiété. Orwell aurait-il cru possible que ces voix de nantis qui l’horripilaient dans les années trente, cette incurie débilitante, cette propension aux guerres à l’étranger et cet accaparement des privilèges se perpétueraient encore gaiement en 2009 ?
- La venue de son trentième anniversaire, trois mois plus tôt, avait précipité la crise existentielle qui couvait en lui à son insu depuis plus d’un an. Assis à 8 heures du matin dans son modeste logement à Oxford, la tête entre les mains, après un jogging de quinze kilomètres qui n’avait pas réussi à soulager son sentiment d’affliction, il avait sondé son âme pour découvrir à quoi avait servi le premier tiers de son existence, sinon à lui fournir un prétexte pour éviter de s’aventurer hors des confins de la cité aux clochers rêveurs.
Pourquoi ?
Vu de l’extérieur, le parcours de Perry était celui d’une parfaite réussite universitaire. L’élève de l’école publique, fils de professeurs du secondaire, arrive à Oxford bardé de diplômes décernés par l’université de Londres, nommé pour trois ans sur un poste offert par l’un des colleges historiques, établissement d’excellence fort bien doté. Son prénom, apanage traditionnel des couches supérieures de la société, lui vient d’Arthur Peregrine, prélat méthodiste originaire de Huddersfield qui soulevait les masses au XIXe siècle.
Pendant le trimestre, quand il n’enseigne pas, il se distingue en cross-country et autres sports, et consacre ses soirées de liberté à un club de jeunes du quartier. Pendant les vacances, il conquiert des sommets difficiles et des voies extrêmes. Mais lorsque son college lui propose un poste permanent (ou plutôt, selon la vision aigrie qu’il en a maintenant, l’emprisonnement à vie), il renâcle.
Là encore : pourquoi ?
Au trimestre précédent, il avait fait un cycle de conférences sur George Orwell intitulé « Une Grande-Bretagne asphyxiée ? » et sa propre rhétorique l’avait inquiété. Orwell aurait-il cru possible que ces voix de nantis qui l’horripilaient dans les années trente, cette incurie débilitante, cette propension aux guerres à l’étranger et cet accaparement des privilèges se perpétueraient encore gaiement en 2009 ?
Ne voyant aucune réaction sur les visages interdits des étudiants qui le fixaient, il s’était donné la réponse lui-même : jamais, au grand jamais, Orwell n’aurait pu croire cela possible, ou alors il serait descendu dans la rue caillasser des vitrines à tour de bras.
C’était un sujet dont il avait rebattu les oreilles à Gail, sa petite amie de longue date, alors qu’ils étaient au lit, après un dîner d’anniversaire, dans l’appartement de Primrose Hill qu’elle avait en partie hérité de son père, par ailleurs sans le sou.
« Je n’aime pas les professeurs et je n’ai pas envie d’en devenir un. Je n’aime pas le monde universitaire et si je ne suis plus jamais obligé de porter une toge à la con, je me sentirai libre », avait-il déclaré à la masse de cheveux châtain clair confortablement nichée sur son épaule.
Ne recevant d’autre réponse qu’un ronronnement compréhensif, il enchaîna.
« Ressasser mon laïus sur Byron, Keats et Wordsworth à une bande d’étudiants qui s’en foutent parce que tout ce qui les intéresse, c’est un diplôme, une bonne baise et un paquet de fric ? Je connais, j’ai donné, et ça me gonfle. »
Puis, montant encore d’un cran :
« La seule chose, ou presque, qui pourrait vraiment me retenir dans ce pays, c’est une putain de révolution. »
Sur quoi Gail, jeune avocate dynamique en pleine ascension, dotée d’un physique avantageux et d’un sens de la repartie parfois un peu trop affûté pour son bien et celui de Perry, l’assura qu’aucune révolution ne saurait se faire sans lui.
Tous deux étaient de facto orphelins. Les parents de Perry avaient incarné les nobles principes de tempérance des socialistes chrétiens, ceux de Gail, tout le contraire. Son père, acteur attendrissant dans sa médiocrité, était mort prématurément d’abus d’alcool, d’une dose quotidienne de soixante cigarettes et d’une passion malavisée pour sa fantasque épouse. Sa mère, actrice elle aussi quoique moins attendrissante, avait quitté la maison quand Gail avait treize ans et, disait-on, vivait d’amour et d’eau fraîche sur la Costa Brava en compagnie d’un assistant caméraman.
Après avoir pris la grande décision, aussi irrévocable que toutes ses grandes décisions, de tirer sa révérence à la vie universitaire, la réaction instinctive de Perry fut de retrouver ses racines. Le fils unique de Dora et d’Alfred allait reprendre leurs convictions à son compte en redémarrant sa carrière là où eux avaient été obligés d’abandonner la leur.
Il allait cesser de jouer les intellectuels de haut vol, s’inscrire à une authentique formation de professeur du second degré et, comme eux, décrocher un poste dans l’une des zones les plus défavorisées du pays.
Il enseignerait les matières au programme, ainsi que tout sport qu’on voudrait bien lui confier, à des enfants qui auraient besoin de lui comme guide pour leur propre épanouissement et non comme tremplin vers la prospérité petite-bourgeoise.
Mais Gail ne s’inquiéta pas autant de ces projets qu’il l’aurait peut-être voulu. Malgré toute sa détermination à se retrouver au coeur de la vraie vie, il restait chez lui d’autres facettes conflictuelles que Gail avait appris à connaître.
Certes, il y avait Perry l’étudiant torturé de l’université de Londres, où ils s’étaient rencontrés, qui, à l’instar de T.E. Lawrence, avait fait route vers la France à bicyclette pendant les vacances et pédalé jusqu’à s’écrouler d’épuisement.
Il y avait aussi Perry l’alpiniste aventureux, incapable de participer à une course ou à un jeu, depuis le rugby à sept jusqu’aux chaises musicales avec les neveux et nièces de Gail à Noël, sans être saisi d’un désir impérieux de gagner.
Mais il y avait aussi Perry le sybarite refoulé, qui s’offrait d’improbables parenthèses de luxe avant de retourner à sa mansarde. Et c’est ce Perry-là qui se trouvait sur le plus beau court de tennis de la plus belle station balnéaire d’Antigua en pleine crise économique, aux premières heures de cette matinée de mai pour éviter un soleil trop écrasant, avec, de l’autre côté du filet, le Russe Dima, tandis que Gail, capeline souple et robe de plage suffisamment vaporeuse pour ne pas cacher son maillot de bain, avait pris place au milieu d’une curieuse assemblée de spectateurs au regard vide, certains vêtus de noir, qui semblaient avoir collectivement prêté serment de ne pas sourire, de ne pas parler et de ne pas manifester le moindre intérêt pour le match qu’on les obligeait à regarder.
Gail s’estimait bien heureuse que l’escapade dans les Caraïbes ait été organisée avant que Perry ne prenne sa grande décision sur un coup de tête. Tout avait commencé au plus sombre de novembre, lorsque son père était mort de ce même cancer qui avait emporté sa mère deux ans plus tôt, laissant Perry dans une modeste aisance. Comme il était contre le principe même de l’héritage, il hésita à donner toute sa fortune aux pauvres, mais, après une guerre d’usure menée par Gail, ils s’étaient décidés pour une offre spéciale de vacances tennistiques inoubliables au soleil.
La date de ce séjour s’avéra on ne peut plus propice, car, tandis qu’approchait leur départ, des décisions encore plus importantes se profilaient devant eux :
Que devait faire Perry de sa vie, et devaient-ils le faire ensemble ?
Gail devait-elle abandonner le barreau pour accompagner aveuglément Perry vers l’horizon radieux, ou poursuivre sa propre carrière fulgurante à Londres ?
Ou bien le temps était-il venu de reconnaître que sa carrière n’était pas plus fulgurante que celle de la plupart des jeunes avocats et donc d’envisager une grossesse, ce que Perry ne cessait de lui répéter ?
Même si Gail, par provocation ou par sécurité, avait pour habitude de faire la part des choses, nul doute qu’ils se trouvaient alors, ensemble et séparément, à la croisée des chemins et qu’ils devaient mener une vraie réflexion, pour laquelle un séjour à Antigua semblait le cadre idéal.
Leur vol ayant été retardé, il était minuit passé quand ils arrivèrent à leur hôtel. Ambrose, le majordome omniprésent de la station, les accompagna à leur bungalow. Ils firent la grasse matinée et, lorsqu’ils eurent pris leur petit-déjeuner sur le balcon, il faisait trop chaud pour jouer au tennis. Ils nagèrent le long d’une plage aux trois quarts vide, déjeunèrent seuls près de la piscine, firent l’amour dans la langueur de l’après-midi et se présentèrent à 18 heures à la boutique tenue par le moniteur, reposés, heureux et impatients de jouer.
Vue de loin, la station se composait d’un simple ensemble de bungalows blancs disséminés le long d’une plage en fer à cheval longue de près de deux kilomètres et recouverte d’un sable fin de carte postale. Les extrémités en étaient marquées par deux promontoires rocheux parsemés de broussailles, entre lesquels couraient un récif de coraux et un cordon de bouées fluorescentes destinées à éloigner les yachts trop curieux. Sur des terrasses en retrait taillées dans le flanc de la colline s’alignaient les courts de tennis de qualité professionnelle. D’étroites marches de pierre qui serpentaient entre des arbustes fleuris menaient à la boutique du moniteur. Une fois entré, on se retrouvait au paradis du tennis, raison pour laquelle Perry et Gail avaient choisi cet endroit.
Il y avait un court central et cinq autres plus petits. Les balles de compétition étaient conservées dans des réfrigérateurs verts et des coupes d’argent exposées dans des vitrines portaient les noms de champions d’autrefois, parmi lesquels Mark, le moniteur australien empâté.
« Alors, on tourne autour de quel niveau, si je puis me permettre ? » demanda-t-il avec une courtoisie appuyée, remarquant sans rien dire la qualité des raquettes éprouvées par le combat, les épaisses chaussettes blanches et les bonnes chaussures de tennis usées de Perry, ainsi que le décolleté de Gail.
Perry et Gail formaient un couple très séduisant, sorti de la prime jeunesse mais encore dans la fleur de l’âge. La nature avait doté Gail de membres longs et bien galbés, de petits seins hauts, d’un corps souple, d’un teint anglais, de beaux cheveux dorés et d’un sourire capable d’illuminer les recoins les plus sombres de la vie. Perry était très anglais dans un autre style, avec son corps dégingandé, désarticulé à première vue, son long cou à la pomme d’Adam saillante, sa démarche gauche, presque vacillante, et ses oreilles décollées. A l’école, on l’avait surnommé la Girafe jusqu’au jour où ceux qui avaient eu l’imprudence de le faire reçurent une bonne leçon. Avec la maturité, il avait acquis (inconsciemment, ce qui n’en était que plus impressionnant) une grâce fragile mais incontestable. Sa tignasse châtain frisée, son large front couvert de taches de rousseur et ses grands yeux derrière ses lunettes lui donnaient un air de perplexité angélique.
Gail, qui ne lui faisait pas confiance pour se hausser du col et avait toujours une attitude protectrice envers lui, prit sur elle de répondre à la question du moniteur.
« Perry joue les éliminatoires du Queen’s et, une fois, il a atteint le tableau final, pas vrai ? Tu es même allé jusqu’aux Masters. Et cela après s’être cassé la jambe au ski et n’avoir pas joué pendant six mois, ajouta-t-elle avec fierté.
– Et vous, madame, oserai-je vous poser la question ? demanda Mark, l’obséquieux moniteur, en insistant un peu trop sur le « madame » au goût de Gail.
– Moi, je suis son faire-valoir, répondit-elle fraîchement.
– N’importe quoi ! » commenta Perry.
L’Australien suçota ses dents, secoua la tête avec incrédulité et feuilleta un carnet mal tenu.
« Eh bien, j’ai un couple qui pourrait vous aller. Ils sont beaucoup trop forts pour mes autres clients, je vous préviens. Enfin, il faut dire que je n’ai pas un choix infini. Vous devriez peut-être faire un petit essai tous les quatre ? »
Ils se retrouvèrent donc opposés à un couple d’Indiens de Bombay en voyage de noces. Le court central était pris, mais le numéro 1 était libre. Bientôt, quelques passants et joueurs venus des autres courts les regardèrent s’échauffer : balles lentes frappées depuis la ligne de fond de court et renvoyées mollement, passing-shots que personne n’essayait de rattraper, smashes au filet qu’on laissait passer. Perry et Gail gagnèrent le tirage au sort, Perry laissa Gail servir en premier, mais elle commit deux doubles fautes et ils perdirent leur engagement. La jeune mariée indienne prit le relais et la partie se poursuivit tranquillement.
C’est lorsque Perry fut au service que la qualité de son jeu éclata au grand jour. Il avait une première balle haute et puissante contre laquelle il n’y avait pas grand-chose à faire quand elle ne sortait pas. Résultat : quatre services gagnants d’affilée. La foule grossit, les joueurs étaient jeunes et beaux, les ramasseurs de balles se découvraient une énergie nouvelle. Vers la fin du premier set, Mark le moniteur passa jeter un coup d’oeil l’air de rien, assista à trois jeux, puis, avec un froncement de sourcils pensif, retourna à sa boutique.
Après un long deuxième set, le score était d’une manche partout. Le troisième et dernier set arriva à 4-3 en faveur de Perry et Gail. Mais alors que Gail avait tendance à retenir ses coups, Perry, lui, donnait toute sa mesure et le match se termina sans que le couple indien remporte un autre jeu.
La foule se dispersa. Les quatre joueurs restèrent pour échanger des compliments, prendre rendez-vous pour la revanche et peut-être boire un verre au bar ce soir ? Avec plaisir. Les Indiens partirent, laissant Perry et Gail récupérer leurs raquettes et leurs pulls.
C’est alors que le moniteur australien revint avec un homme musclé, très droit, au torse énorme, complètement chauve, qui portait une Rolex en or incrustée de diamants et un pantalon de survêtement gris retenu à la taille par un cordon noué.
LES BLOGUEURS ET BLOGUEUSES QUI Y PARTICIPENT AUSSI :
• Au baz’art des mots • Light & Smell • Les livres de Rose • Lady Butterfly & Co • Le monde enchanté de mes lectures • Cœur d’encre • Les tribulations de Coco • La Voleuse de Marque-pages • Vie quotidienne de Flaure • Ladiescolocblog • Selene raconte • La Pomme qui rougit • La Booktillaise • Les lectures d’Emy • Aliehobbies • Rattus Bibliotecus • Ma petite médiathèque • Prête-moi ta plume • L’écume des mots• Chat’Pitre • Pousse de ginkgo • Ju lit les mots• Songe d’une Walkyrie • Mille rêves en moi• L’univers de Poupette • Le parfum des mots • Chat’Pitre • Les lectures de Laurine • Lecture et Voyage • Eleberri • Les lectures de Nae • Tales of Something • CLAIRE STORIES 1, 2, 3 ! • Read For Dreaming • À vos crimes
• Au baz’art des mots
• Lady Butterfly & Co
• Le monde enchanté de mes lectures
• Cœur d’encre
• Les tribulations de Coco
• Vie quotidienne de Flaure
• Ladiescolocblog
• Selene raconte
• La Pomme qui rougit
• Aliehobbies
• Ma petite médiathèque
• Pousse de ginkgo
• À vos crimes
• Le parfum des mots
• Claire Stories 1, 2, 3
• Ju lit les mots
• Illie’z Corner
• Voyages de K
• Prête-moi ta plume
• Les lectures de Val
• Le petit monde d’Elo
• Les paravers de Millina
• Mon P’tit coin de lectures
• Critiques d’une lectrice assidue
• sir this and lady that
• Livres en miroir

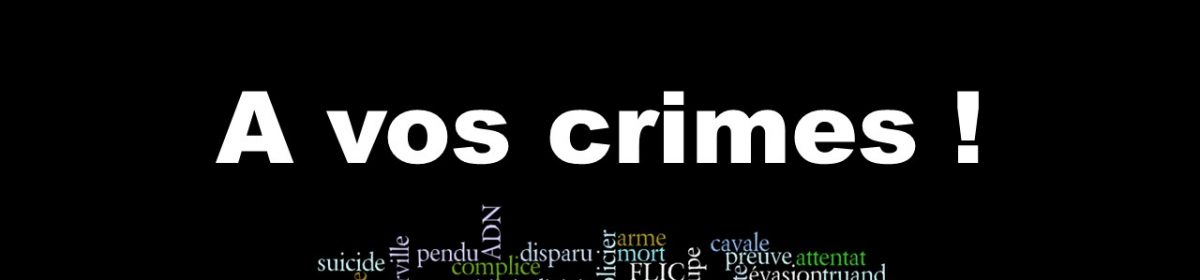

merci
J’aimeJ’aime