PREMIÈRES LIGNE #46
Bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du dimanche : premières lignes, créé par Ma Lecturothèque.
Le concept est très simple, chaque dimanche, il faut choisir un livre et en citer les premières lignes.
Je poursuis aujourd’hui avec vous ce nouveau rendez-vous hebdomadaire !
Et merci à Aurélia pour ce challenge.
Le livre en cause

Le Dahlia noir de James Ellroy

Prologue
Vivante, je ne l’ai jamais connue, des choses de sa vie je n’ai rien partagé. Elle n’existe pour moi qu’au travers des autres, tant sa mort suscita de réactions transparaissant dans le moindre de leurs actes. En remontant dans le passé, ne cherchant que les faits, je l’ai reconstruite, petite fille triste et putain, au mieux quelqu’un-qui-aurait-pu-être, étiquette qui pourrait tout autant s’appliquer à moi. J’aurais souhaité pouvoir lui accorder une fin anonyme, la reléguer aux quelques mots laconiques du rapport final d’un inspecteur de la Criminelle, avec copie carbone pour le bureau du coroner, et quelques formulaires supplémentaires avant qu’on ne l’emmène à la fosse commune. La seule chose qui ne cadrait pas avec ce souhait, c’était qu’elle n’aurait pas voulu qu’il en fût ainsi. Malgré la brutalité des faits, elle aurait désiré que tout en fût connu. Et puisque je lui dois beaucoup, puisque je suis le seul qui connaisse vraiment toute l’histoire, j’ai entrepris la rédaction de ce mémoire.
Mais avant le Dahlia, il y eut mon partenaire, et avant cela encore, il y eut la guerre, les règlements et manœuvres militaires à la Division de Central, qui nous rappelaient que, flics, nous étions aussi soldats, bien que moins populaires, et de beaucoup, que ceux qui combattaient les Allemands et les Japs. Jour après jour, le service terminé, on nous obligeait à participer à des simulations d’alerte aérienne, des simulations de couvre-feu, des simulations d’évacuation d’incendie qui nous tenaient tous debout, au garde à vous, sur Los Angeles Street, dans l’espoir d’une attaque de Messerschmitt qui nous aurait donné l’illusion de paraître moins stupides. L’appel des équipes de jour se faisait par ordre alphabétique et peu de temps après l’obtention de mon diplôme de l’Académie, en août 1942, c’est là que je rencontrai Lee.
Je le connaissais déjà de réputation et j’avais nos palmarès respectifs inscrits noir sur blanc : Lee Blanchard, 43 victoires, 4 défaites, 2 nuls comme poids lourd, autrefois attraction régulière du Legion Stadium à Hollywood et moi : Bucky Bleichert, mi-lourd, 36 victoires, zéro défaite, zéro nul, jadis classé dixième par Ring Magazine, probablement parce que Nat Fleister trouvait amusante ma manière de taquiner mes adversaires de mes grandes dents de cheval. Les statistiques ne disaient pas tout et pourtant Blanchard cognait dur, encaissant six coups pour en rendre un, le modèle classique du boxeur qui cherche la tête ; moi, je dansais, frappant en contre avec crochets au foie, la garde toujours haute, craignant toujours que trop de coups au visage ne me démolissent ma petite gueule plus encore que ne l’avaient fait mes dents. Question style, Lee et moi étions comme l’eau et l’huile, et, chaque fois que nos épaules se frôlaient à l’appel, je me demandais toujours lequel de nous deux gagnerait.
Nous passâmes près d’une année à prendre la mesure l’un de l’autre. Jamais nous ne parlâmes boxe ou travail de police, limitant notre conversation à quelques banalités sur le temps. Au physique, nous étions aussi opposés, autant que deux grands costauds peuvent l’être : Blanchard était blond et rougeaud, 1,80 m, la poitrine profonde et les épaules larges, les jambes maigrichonnes et arquées et un ventre dur qui commençait à se relâcher ; j’avais le teint pâle et les cheveux sombres, 1,87 m de minceur musclée. Lequel gagnerait ?
Finalement, je mis un terme à mes tentatives pour prédire le vainqueur. Mais d’autres flics avaient pris le relais et, durant cette première année à Central, j’entendis des douzaines d’opinions : Blanchard K.O. avant la limite ; Bleichert par décision de l’arbitre ; Blanchard par arrêt de l’arbitre ou abandon sur blessures – tout, sauf Bleichert par K.O.
Une fois hors de portée des regards, j’entendais des murmures sur nos histoires extra-pugilistiques : l’arrivée de Lee sur la scène du L.A.P.D., assuré qu’il était d’une promotion rapide parce qu’il acceptait les combats au finish et en privé sous l’œil des huiles de la police et de leurs potes politiciens, Lee qui, en 39 déjà, avait résolu le braquage de la banque Boulevard-Citizens, puis était tombé amoureux de la petite amie d’un des braqueurs et avait fait foirer une promotion certaine à la Criminelle lorsque la nana avait emménagé chez lui – en violation des principes du service concernant les couples à la colle – en le suppliant d’abandonner la boxe. Les rumeurs sur Blanchard me touchèrent comme des feintes de directs, et je me demandais quelle en était la part de vérité. Les bribes de ma propre histoire m’atteignaient comme autant de coups au corps, car c’était tout sauf des tuyaux crevés : Dwight Bleichert ne s’engageait dans le service que parce qu’il lui fallait fuir des événements bigrement plus difficiles comme la menace d’une expulsion de l’Académie lorsque avait éclaté au grand jour l’appartenance de son père à l’Alliance germano-américaine ; on avait fait pression sur lui pour qu’il dénonce à la Brigade des Étrangers, les Japonais parmi lesquels il avait grandi, afin de pouvoir assurer sa nomination au L.A.P.D. On ne lui avait pas demandé de combat au finish, parce que ce n’était pas un cogneur qui gagnait par K.O.
Blanchard et Bleichert ; un héros et une donneuse.
Le simple souvenir de Sam Murakami et de Hideo Ashida, menottes aux poignets, en route pour Manzanar contribua à rendre les choses simples pour nous deux. Au départ. Puis nous allâmes au combat côte à côte, et mes impressions premières sur Lee – et moi-même – volèrent en éclats.
C’était au début de juin 43. La semaine précédente, des marins s’étaient pris de querelle avec des Mexicains en costards nanars de zazous sur Lick Pier à Venice. La rumeur voulait que l’un des matafs ait perdu un œil. Des bagarres larvées commencèrent à éclater sur le continent : personnels de la Marine et de la Base navale de Chavez Ravine contre Pachucos d’Alpine et Palo Verde. Les journaux eurent vent d’un tuyau selon lequel les endimanchés trimbalaient des emblèmes nazis avec leurs crans d’arrêt, et des centaines de soldats en tenue, marins et Marines, descendirent sur le centre-ville de L.A., armés de bâtons et de battes de base-ball. Un nombre égal de Pachucos étaient censés se rassembler près de la brasserie Brew 102 sur Boyle Heights, équipés d’un arsenal similaire. Chaque agent de patrouille de la Division de Central fut rappelé en service pour se voir équipé d’un casque de la Première Guerre mondiale et d’une matraque géante connue sous le nom de tanne-négros.
Au crépuscule, on nous amena sur le champ de bataille en camions empruntés à l’armée, avec, pour seule directive, de restaurer l’ordre. On nous avait ôté nos revolvers réglementaires au poste ; les huiles ne voulaient pas que des .38 tombent entre les mains de gangsters mexicains en costards nanars, pli rasoir, revers pépère, épaulettes gonflettes, et chevelure plaquée à l’Argentine, en queue de canard. En bondissant hors du transporteur de troupes sur Evergreen et Wabash, tenant deux kilos de matraque par la poignée garnie d’adhésif antidérapant, je me pris une trouille dix fois plus forte que toutes mes frayeurs sur le ring, et pas parce que le chaos nous tombait dessus de tous côtés.
J’étais terrifié parce que les méchants, c’était cette fois les bons.
Des marins défonçaient les vitrines d’Evergreen à coups de pied ; des Marines en treillis bleus démolissaient les lampadaires de manière systématique, pour offrir au théâtre de leurs opérations toujours un peu plus d’obscurité. Les rivalités interservices un instant oubliées, soldats et matelots retournaient les voitures garées en face d’une bodega pendant que, juste à côté, sur le trottoir, des jeunots de la Navy, en vareuse et pattes d’eph blancs, tabassaient à coups de matraque un groupe d’endimanchés submergés par le nombre. À la périphérie du champ d’action, je voyais des groupes de collègues policiers en train de frayer avec les nervis de la patrouille de Plage et des M.P.
Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, engourdi, ne sachant que faire. Finalement mon regard se porta sur Wabash en direction de la 1re Rue et je vis des petites maisons et des arbres, pas de Pachucos, pas de flics, pas de G.Is assoiffés de sang. Avant même de savoir ce que je faisais, je me mis à courir à toute vitesse. J’aurais continué à courir jusqu’à ce que je tombe, mais un éclat de rire retentit haut et clair sous un porche d’entrée et m’arrêta net.
Je m’avançai dans la direction du bruit. Une voix haut perchée résonna :
– Vous êtes le deuxième jeune flic à prendre la tangente devant le chambard. Je vous en blâme pas. C’est pas facile de savoir à qui passer les bracelets, hein ?
Debout sur le perron, je regardai le vieil homme. Il dit :
– À la radio, y z’ont dit que les taxis, y z’ont pas arrêté de remonter jusqu’à Hollywood, aux U.S.O.1 pour en ramener les matelots. La K.F.I.2 a appelé ça une agression navale, ils arrêtent pas de passer Anchors Aweigh3 toutes les heures et demie. J’ai vu des Marines en bas de la rue. Vous croyez que c’est ce que vous appelez une attaque amphibie ?
– Je ne sais pas ce que c’est, mais j’y retourne.
– Z’êtes pas le seul à avoir tourné casaque, vous savez. Un aut’ grand balèze est passé par ici en cavalant pronto.
Papy commençait à ressembler à une version rusée de mon père.
– Y a quelques Pachucos qui ont besoin qu’on leur remette les idées en place.
– Tu crois que c’est aussi simple, fiston ?
– Je ferai en sorte que ce soit aussi simple.
Le vieil homme gloussa de plaisir. Je descendis du perron et retournai où le devoir m’appelait, en me tapotant la jambe avec le tanne-négros. Tous les lampadaires étaient maintenant hors d’usage ; il était presque impossible de faire la différence entre les G.Is et les Supersapés. De le savoir m’offrit une porte de sortie facile pour échapper à mon dilemme, et je m’apprêtai à charger. C’est alors que j’entendis « Bleichert ! » derrière moi et je sus qui était le second coureur à pied.
Je fis demi-tour au pas de course. Il y avait là Lee Blanchard, le « bon espoir blanc mais pas génial des quartiers Sud », défiant trois Marines en uniforme et un Pachuco en costard, sapé de pied en cap. Il les avait coincés dans l’allée centrale d’une cour de bungalow merdique et les tenait à distance en détournant leurs coups de son tanne-négros. Les trois crânes d’œuf lui balançaient de grands moulinets de leurs bâtons, et le rataient lorsque Blanchard esquivait à gauche et à droite, d’avant en arrière, toujours en sautillant. Le Pachuco tripotait d’une main caressante et l’air égaré les médailles religieuses autour de son cou.
– Bleichert, code trois.
Je me mis de la partie, à coups de trique bien appliqués, touchant de mon arme boutons de laiton brillants et rubans honorifiques. J’encaissai quelques coups de matraque maladroits sur les bras et les épaules et je poussai mon avance de manière à empêcher les Marines de mouliner à tour de bras. C’était comme si j’étais au corps à corps avec un poulpe, sans arbitre et sans gong toutes les trois minutes, mais l’instinct fut le plus fort, je laissai tomber ma matraque, baissai la tête et commençai à balancer de grands coups au corps, touchant des ventres de gabardine molle. Puis j’entendis : « Bleichert, reculez ! »
Je m’exécutai, et Lee Blanchard apparut, le tanne-négros bien haut au-dessus de la tête. Les Marines, abasourdis, se figèrent ; la matraque s’abattit : une fois, deux fois, trois fois, net et clair sur les épaules. Lorsque le trio fut réduit à un tas de décombres en uniforme bleu, Blanchard dit : « Jusqu’aux palais de Tripoli connards4 ! » et se retournant vers le Pachuco : « Holà ! Tomas. »
Je secouai la tête et m’étirai. J’avais les bras et le dos douloureux, les jointures de mon poing droit palpitaient. Blanchard passait les menottes au Supersapé et tout ce que je trouvai à dire, ce fut :
Blanchard sourit.
– Pardonnez-moi mes mauvaises manières : Agent Bucky Bleichert, puis-je vous présenter le Señor Tomas Dos Santos, objet d’un avis de recherches à toutes les unités pour meurtre perpétré pendant l’exécution d’un crime au deuxième degré. Tomas a volé à l’arraché le sac d’un vieux boudin au coin de la 6e et d’Alvaredo, la vieille a piqué du nez, crise cardiaque, et elle a cassé sa pipe. Tomas a laissé tomber le sac, et s’est tiré vite fait – en laissant de belles grosses empreintes sur le sac, avec en plus des témoins oculaires.
Blanchard fila un coup de coude à l’homme :
– Habla Inglés, Tomas ?
Dos Santos secoua la tête, signe que non ; Blanchard secoua la sienne avec tristesse :
– C’est de la viande froide. Meurtre au deuxième degré, c’est direct la chambre à gaz pour les spics5. Le petit zazou, il est à six semaines du Grand Plongeon.
J’entendis des coups de feu en provenance de Wabash et Evergreen. Debout sur la pointe des pieds, je vis des flammes jaillir d’une rangée de vitrines brisées et exploser en éclairs bleus et blancs lorsqu’elles atteignaient les cibles des tramways et les lignes téléphoniques. Je baissai les yeux sur les Marines, et l’un d’eux me fit un geste obscène du doigt.
– J’espère que ces mecs n’ont pas pris votre numéro matricule, lui dis-je.
– Qu’ils aillent se faire empapaouter s’ils l’ont noté.
Je lui montrai du doigt un bouquet de palmiers que les flammes transformaient en boules de feu.
– Jamais nous ne pourrons le faire coffrer ce soir. Vous avez couru jusqu’ici pour les alpaguer, vous croyez…
Blanchard me fit taire d’un petit direct espiègle qui s’arrêta juste devant ma plaque.
– J’ai couru jusqu’ici parce que je savais qu’y avait pas le moindre putain de truc que j’pouvais faire pour remettre de l’ordre, et si jamais je traînais dans le coin, je risquais de me faire buter. Ça vous rappelle quelque chose ?
– Ouais, dis-je en riant. Et puis vous…
– Et puis j’ai vu les merdeux à la poursuite du p’tit futé, qui ressemblait étrangement au suspect du mandat d’amener numéro quatre onze tiret quarante trois. Ils m’ont coincé ici, et je vous ai vu faire demi-tour en quête de quelques coups, aussi j’ai pensé qu’il valait mieux que vous vous preniez des coups pour quelque chose. Ça se tient, non ?
– Ça a fonctionné.
Deux des Marines avaient réussi à se remettre sur pied et aidaient le troisième à se relever. Quand ils démarrèrent à trois de front, direction le trottoir, Tomas Dos Santos balança une solide botte du pied droit dans le plus gros des trois culs. Le soldat de première classe qui en était le proprio se retourna face à son attaquant ; je fis un pas en avant. Abandonnant alors leur campagne de L.A. Est, tous les trois partirent en clopinant en direction de la rue, des coups de feu et des palmiers en flammes. Blanchard ébouriffa la chevelure de Dos Santos :
– T’es un petit merdeux tout mignon mais t’es un homme mort. Amenez-vous, Bleichert, on va se trouver un coin et attendre que ça se passe.
À quelques blocs de là, nous trouvâmes une maison avec une pile de quotidiens sous le porche d’entrée. Une fois la serrure forcée, nous entrâmes. Il y avait deux bouteilles de Cutty Sark dans le placard de la cuisine. Blanchard fit passer les bracelets des poignets de Dos Santos à ses chevilles de manière qu’il ait les mains libres pour picoler. Pendant que je préparais des sandwiches au jambon et des whiskies à l’eau, le Pachuco s’était sifflé la moitié d’une bouteille et beuglait Cielito Lindo et une version mexicaine de Chattanooga Choo Choo. Une heure plus tard, la bouteille était morte et Tomas dans les vapes. Je le soulevai pour le poser sur le canapé, je lui balançai une couverture et Blanchard déclara :
– C’est mon neuvième criminel pour 43 ; y va téter le gaz dans moins de six semaines et moi, dans moins de trois ans, je bosserai pour Central ou Nord-Est, au service des Mandats et Recherches de criminels en fuite.
Son assurance me resta sur l’estomac :
– Tintin. Vous êtes trop jeune, vous n’êtes pas encore passé sergent, vous êtes à la colle avec une nana, vous avez perdu tous vos potes parmi les grosses huiles lorsque vous avez abandonné les combats au finish et vous n’avez pas encore fait votre période en civil.
– Vous…
J’arrêtai lorsque Blanchard sourit avant d’aller jusqu’à la fenêtre du salon pour regarder au-dehors.
– Incendies sur Michigan et Soto. Joli !
– Joli ?
– Ouais, joli. Vous en connaissez un bout sur moi, Bleichert.
– Les gens parlent à votre sujet.
– Ils parlent aussi à votre sujet.
– Que disent-ils ?
– Que votre vieux, c’est un genre de radoteur nazi. Que vous avez cafté votre meilleur ami aux Fédés pour entrer dans le Service. Que vous avez étoffé votre palmarès de boxeur en combattant avec des mi-lourds qu’on avait un peu gonflés.
Les mots restèrent suspendus dans l’air comme trois chefs d’accusation.
– Et c’est tout ?
– Non, dit Blanchard en se retournant pour me faire face. On dit aussi que vous ne courez jamais la chagatte et que vous croyez que vous pouvez m’avoir.
– Tout ce qu’on vous a dit est vrai, dis-je en acceptant le défi.
– Ouais ? Ben, pour moi, c’est pareil. Excepté que je suis sur la liste des postulants sergents, que je suis muté aux Mœurs de Highland Park en août et qu’y a un petit Juif, assistant du Procureur qui en fait dans son froc quand y voit un boxeur. Il m’a promis le premier poste aux Mandats et Recherches qu’il pourra dégoter.
– Je suis impressionné.
– Ouais ? Vous voulez entendre quelque chose d’encore plus impressionnant ?
– Envoyez !
– Mes vingt premiers K.O., c’était des clodos alcoolos choisis par mon manager. Ma petite amie vous a vu combattre à l’Olympic et a dit que vous seriez beau gosse si vous vous faisiez arranger les dents, et aussi que vous pourriez peut-être m’avoir.
J’étais incapable de dire si, en ce lieu, à cette heure, l’homme cherchait la bagarre ou une amitié ; s’il était en train de me tester, de se payer ma figure, ou de me soutirer des renseignements. Je montrai du doigt Tomas Dos Santos agité de tics et de soubresauts dans son sommeil de gnôle.
– On fait quoi du Mex ?
– Nous le mettrons au trou demain matin.
– C’est vous qui le mettrez au trou.
– La prise, vous y êtes de moitié.
– D’accord, partenaire.
– Je ne suis pas votre partenaire.
– Un jour, peut-être.
– Ou peut-être jamais, Blanchard. Peut-être que vous bosserez aux Mandats et Recherches, que vous vous ferez du blé avec les impayés et les assignations à remettre aux bavards véreux du centre-ville, peut-être que je ferai mes vingt balais pour toucher ma pension et me trouver un petit boulot pépère quelque part.
– Vous pourriez aller aux Fédés. Je sais que vous avez des potes à la Brigade des étrangers.
– Ne poussez pas le bouchon trop loin là-dessus.
Blanchard regarda à nouveau par la fenêtre.
– Joli. Ça ferait une bonne carte postale : « Chère maman, j’aimerais que tu sois parmi nous à L.A. Est, les émeutes raciales sont très colorées. »
Tomas Dos Santos remua en marmonnant : « Inez ? Inez ? Qué ? Inez ? » Blanchard alla jusqu’à un placard du couloir et en rapporta un vieux pardessus en lainage qu’il lui balança dessus. La chaleur supplémentaire parut l’apaiser ; ses marmonnements s’éteignirent.
– Cherchez la femme6. Hein, Bucky ?
– Comment ?
– Cherchez la femme7. Même plein de gnôle comme une outre, le vieux Tomas ne peut pas laisser partir Inez. Je vous prends à dix contre un que, lorsqu’il mettra le pied dans la chambre à gaz, elle sera là aussi, tout à ses côtés.
– Il cherchera peut-être à plaider coupable. De quinze à perpète, y sera sorti dans vingt balais.
– Non. C’est un homme mort. Cherchez la femme8, Bucky. N’oubliez pas ça.
Je parcourus la maison en quête d’un lieu où dormir, pour finalement m’installer dans une chambre du rez-de-chaussée sur un lit bancal trop court pour mes jambes. Une fois allongé, j’écoutai les sirènes et les coups de feu dans le lointain. Petit à petit, je m’assoupis et rêvai de femmes, le peu que j’en avais eu, de loin en loin.
Au petit matin, les émeutes s’étaient apaisées, laissant un ciel couvert de suie et des rues jonchées de bouteilles d’alcool vides et de bâtons et de battes de base-ball abandonnés. Blanchard appela le poste de Hollenbeck pour qu’on transporte en voiture pie son neuvième criminel de 43 jusqu’à la prison du palais de Justice, et Tomas Dos Santos se mit à pleurer en nous quittant lorsque les policiers l’emmenèrent. Blanchard et moi nous serrâmes la main sur le trottoir avant de rejoindre le centre-ville par des itinéraires séparés, lui direction le bureau du Procureur pour rédiger son rapport sur la capture du voleur à l’arraché, moi direction le poste de Central et une nouvelle journée de service.
Le conseil municipal de L.A. déclara hors-la-loi le port du costume zazou et Blanchard et moi retournâmes à nos conversations polies au moment de l’appel. Et tout ce qu’il avait déclaré cette nuit-là dans la maison vide, avec sa certitude inébranlable, se réalisa.
Blanchard fut promu sergent et transféré aux Mœurs de Highland Park au début d’août, et Tomas Dos Santos passa à la chambre à gaz la semaine suivante. Trois années s’écoulèrent, et je continuai mes patrouilles en voiture-radio au poste de Central. Puis un matin je jetai un coup d’œil au tableau des transferts et promotions et vis tout en haut de la liste : Blanchard, Leland, C., Sergent, Mœurs, Highland Park, muté aux Mandats et Recherches de Central, date d’effet 15-9-46.
Et, bien sûr, nous fîmes équipe. En y repensant, je sais que cet homme ne possédait pas le don de prophétie ; il œuvrait simplement dans le but d’assurer son avenir, tandis que je pédalais dans l’incertain en direction du mien. C’était son Cherchez la femme, dit d’une voix monocorde, et qui continue à me hanter. Parce que notre équipe ne fut rien d’autre qu’une route cahotante qui menait au Dahlia. Au bout du compte, elle devait nous posséder l’un et l’autre, totalement.
1. U.S.O. : United Service Organizations.
2. K.F.I. : Station de radio.
3. Hymne de la Navy : « Levez l’ancre. »
4. Raccourci de l’hymne des Marines américains, Des palais de Montezuma jusqu’aux rivages de Tripoli.
5. Spic : péjoratif ; ici, pour désigner un Mexicain.
6. En français dans le texte.
7. En français dans le texte.
8. En français dans le texte.
Les blogueurs et blogueuses qui y participent aussi :
• Au baz’art des mots • Light & Smell • Les livres de Rose • Lady Butterfly & Co • Le monde enchanté de mes lectures • Cœur d’encre • Les tribulations de Coco • La Voleuse de Marque-pages • Vie quotidienne de Flaure • Ladiescolocblog • Selene raconte • La Pomme qui rougit • La Booktillaise • Les lectures d’Emy • Aliehobbies • Rattus Bibliotecus • Ma petite médiathèque • Prête-moi ta plume • L’écume des mots
• Chat’Pitre • Pousse de ginkgo • Ju lit les mots
• Songe d’une Walkyrie • Mille rêves en moi
• L’univers de Poupette • Le parfum des mots • Chat’Pitre • Les lectures de Laurine • Lecture et Voyage • Eleberri • Les lectures de Nae • Tales of Something • CLAIRE STORIES 1, 2, 3 ! • Read For Dreaming • À vos crimes

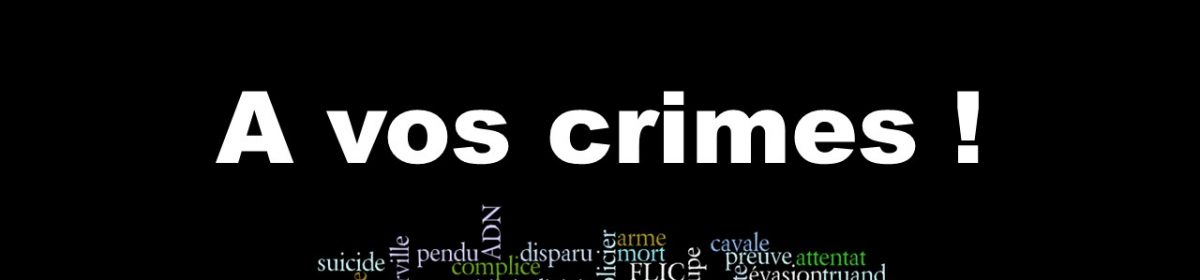

Ce roman me fait très envie ! Il faudra que je regarde s’il est à la bibliothèque, à l’occasion =)
J’aimeAimé par 1 personne
Oh c’est certain il doit être à la bibliothèque c’est un classique maintenant !
J’aimeAimé par 1 personne
Il y est, je l’ai noté dans ma liste 😉
J’aimeAimé par 1 personne
ah trop chouette ça ! 😄
J’aimeAimé par 1 personne